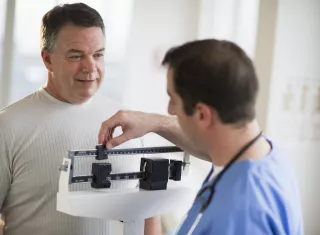L’IRDES a interrogé des patients diabétiques pour mieux comprendre ce qui freine ou facilite le suivi de leur traitement — une enquête qui offre aussi des clés précieuses aux soignants pour renforcer leur accompagnement.
Gérer sa santé au long cours avec un diabète de type 2 peut s’avérer compliqué selon sa situation sociale et ses ressources.
Une enquête réalisée par l’IRDES auprès de 84 personnes malades dans cinq régions françaises (Auvergne-Rhône- Alpes, Bretagne, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et île de La Réunion) a cherché ce qui facilite ou, au contraire, rend plus difficile le suivi du traitement du diabète de type 2. Les sujets interrogés faisaient partie des 4984 participants à l’enquête Entred 3. Cette enquête révélait, en 2019, un vieillissement de la population atteinte de diabète de type 2, une augmentation de l’ancienneté du diabète et l’absence de progrès dans la maîtrise des facteurs de risque de complications (poids, tabagisme) par rapport aux données de 2007.
Trois types de rapport à la maladie
Les entretiens semi-directifs réalisés entre 2020 et 2022 ciblent quatre dimensions de la gestion de la maladie : l’alimentation, l’activité physique, la gestion du traitement et le suivi de la maladie. Ils se sont appuyés sur le concept de littératie en santé, qui se rapporte à l’ensemble des compétences cognitives (lire, écrire, calculer) et sociales (communiquer) que les personnes mobilisent, pour accéder aux informations et services nécessaires à la prise de décision concernant leur santé, et pour les comprendre, les retenir, les utiliser et les évaluer.
Ces entretiens ont permis de catégoriser en trois types le rapport à la maladie : un rapport « instrumental/fonctionnel » (simple application des consignes), un rapport « interactif » (capacités d’adaptation des consignes), ou un rapport « critique » (gestion plus active et stratégique). Ces rapports se réfèrent à la capacité des personnes à mettre en œuvre des pratiques appropriées pour maintenir l’équilibre de leur diabète, à en comprendre le sens et à adapter celles-ci en tenant compte de leurs besoins et des ressources du système de santé.
Un rapport fonctionnel à l’alimentation
La moitié des personnes interrogées exprime un rapport « fonctionnel » à l’alimentation, sans regard critique et de façon identique et/ou répétitive : limitation de certains aliments, ajout ou remplacement par d’autres, diminution des quantités, voire suppression d’aliments contenant du sucre.
L’autre moitié est, soit dans un rapport « interactif », soit dans un rapport « critique » à l’alimentation. Les premières ont conscience de la possibilité d’agir sur la maladie et elles engagent des compétences cognitives et sociales pour adapter certaines pratiques à des situations changeantes (évolution de la maladie, nouveaux environnements). Cependant, si elles ont pris conscience que leur alimentation doit être plus variée et diversifiée, elles ne remettent pas en cause leurs pratiques alimentaires habituelles. Les personnes exprimant un rapport critique à l’alimentation vont, elles, plus loin : elles ont intégré la présence de la maladie dans les pratiques alimentaires quotidiennes et adaptent celles-ci selon les circonstances.
Pour une grande partie des sujets, ces ajustements ont été adoptés à la suite de recommandations de leurs soignants (généraliste ou diététicienne). Toutefois, le suivi de ces recommandations et leur maintien sur le long terme dépend beaucoup du soutien de l’entourage proche, qui adopte parfois certaines habitudes alimentaires ou s’implique dans la mise en pratique des recommandations. Autre frein possible à l’accès à une alimentation de qualité, les contraintes financières et une faible accessibilité aux produits (pain complet, aliments locaux, bio, etc.) pour un tiers des sujets. Des exemples de menus leur ont été proposés sans tenir compte de leurs situations sociale et financière.
Un rapport plus actif à l’activité physique
Au sujet de l’activité physique, les personnes ont majoritairement un rapport « interactif » (31 personnes sur 84) et « critique » (27 sur 84). Elle était pratiquée avant le diagnostic du diabète et est perçue comme un moyen d’apporter un bénéfice sur l’équilibre et la glycémie. La régularité de la pratique est facilitée par le soutien familial ou amical ainsi que par la proximité des lieux de pratique possible. La marche à pied est l’activité physique la plus choisie dans le cadre de l’étude. Parfois, la pratique d’activité physique peut être empêchée par des problèmes physiques liés au vieillissement ou au surpoids. Parmi les personnes interrogées, seule une dizaine évoque le fait d’avoir reçu les conseils d’un médecin, et les recommandations restent floues quant au choix de l’activité physique adaptée à la personne, ou peu compatible avec sa situation financière.
Un rapport fonctionnel au traitement
Deux tiers des personnes rencontrées se trouvent dans un rapport « fonctionnel » au traitement (51 sur 84 personnes enquêtées) et un peu plus de la moitié (48 sur 84) dans un rapport également « fonctionnel » au suivi de la maladie. Elles disent essayer de suivre le mieux possible le traitement prescrit, surveiller au jour le jour leur glycémie lorsque cela leur est recommandé, et consulter régulièrement les professionnels de santé.
Quant au tiers de personnes avec un rapport « interactif » ou « critique », le traitement et la surveillance de la maladie font parfois l’objet d’adaptations, discutées avec le médecin en fonction des habitudes de vie des personnes.
Pour les personnes interrogées, le médecin généraliste fait office de référent principal et est reconnu pour ses compétences relationnelles et médicales. Il est l’interlocuteur privilégié en matière d’informations sur le diabète (53 sur 84 personnes interrogées) devant internet et Sophia, le programme de l’Assurance maladie. Toutefois, une dizaine de personnes ont souligné le manque de disponibilité du médecin généraliste et la difficulté d’accès à un diabétologue. La moitié des personnes interrogées n’a d’ailleurs jamais consulté de diabétologue. Très peu ont également suivi des séances d’éducation thérapeutique (20 personnes).
Comme la littératie en santé, les rapports à la gestion de la santé apparaissent liés au niveau d’études. Plus le niveau scolaire est élevé, plus les rapports à la gestion de la santé sont « interactifs » et « critiques ».
La pluralité des pratiques et des besoins doit inviter les professionnels de santé à prendre en compte les rapports qu’entretient son patient à la gestion de sa santé, à investir davantage la dimension relationnelle des soins, à utiliser un langage clair et adapté au niveau de littératie de chaque personne, à développer une posture éducative s’appuyant sur les ressources des personnes, via des techniques de communication favorisant l’écoute active et la reformulation.
Gérer sa santé avec un diabète de type 2. Les apports de la recherche qualitative Diab-quali. D. Bal- let, M. Balcou-Debussche, C. Fournier, S. Fosse-Edorh. https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de- lasante/299-gerer-sa-sante-avec-un-diabete-de-type-2.pdf
C. Costa ©
C. Costa © Société Française de Nutrition. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Date de publication : 29/10/2025
| Pour vous abonner et retrouver tous les articles des Cahiers de Nutrition et de Diététique, cliquez ici |